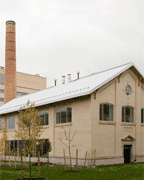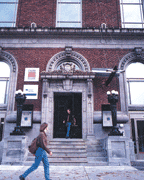Voir ce pavillon sur la carte interactive >>
Historique du pavillon Judith-Jasmin
Situé au 405, rue Sainte-Catherine Est, le pavillon Judith-Jasmin a été construit entre 1976 et 1979 par Louis Donolo Inc. La conception du pavillon avait été confiée aux firmes d'architectes Dimitri Dimakopoulos et Associés et Jodoin, Lamarre, Pratte et Associés. Localisé sur le site historique de l’ancienne église Saint-Jacques, l’intégration d’éléments architecturaux de style néo-gothique du vieux bâtiment existant forme les bases de l’architecture unique de ce pavillon témoignant d’un riche passé.
Érigée entre 1823 et 1825 par l’architecte Joseph Fournier, l’église Saint-Jacques le Majeur, première cathédrale de Montréal, est détruite par le feu en 1852 puis reconstruite rue Dorchester. L’église Saint-Jacques, reconstruite par l’architecte John Ostell sur le site de l’ancienne cathédrale, est bénie en 1857. Un nouvel incendie fait rage en 1858. La reconstruction de l’église est effectuée par l’architecte Victor Bourgeau et se termine en 1860. En 1876, une flèche est ajoutée et porte le clocher à une hauteur de 85 mètres; il est surmonté, en 1905, d’un majestueux coq en or. En 1889, un transept sud donnant sur la rue Sainte-Catherine est annexé par les architectes Perrault, Mesnard et Joseph Venne. Ayant subi de nombreux travaux de réfection et affligé d’un nouvel incendie en 1933, l’édifice acquis par l’Université en 1973 manque d’intégration et d’esthétisme. Seuls seront conservés le clocher et la façade du transept sud de l'église, classés monuments historiques en 1973, ainsi que les boiseries, le mobilier et les verrières de l'ancienne sacristie, classés biens culturels, la même année.
Respectant l’échelle des bâtiments du quartier et de l’ancienne église, le pavillon, relié à la station de métro Berri-UQAM se veut un lieu facilement accessible, favorisant les échanges avec le milieu. D'ailleurs, son clocher, qui surplombe le quartier latin, est considéré souvent comme point de repère. En 1980, le prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec est décerné aux architectes de ce pavillon. Doté d’une place centrale ceinturée d’espaces socioculturels, communautaires et académiques, ce pavillon constitue, en quelque sorte, le centre névralgique du campus. On y retrouve également la Galerie de l’UQAM, la salle Marie-Gérin-Lajoie, le studio-théâtre Alfred-Laliberté, ainsi que la Salle des boiseries, composée des œuvres de l’ancienne sacristie.
Nommé suite à une consultation auprès de la communauté universitaire, cet édifice porte le nom de pavillon Judith-Jasmin (1916-1972). Après des études au Lycée Versailles de Paris puis au Collège Marguerite-Bourgeois à Montréal, Judith Jasmin se fait connaître comme comédienne en 1938 par son rôle d’Élise Velder dans le roman radiophonique La pension Velder de Radio-Canada, rôle qu’elle tiendra pendant douze ans. À l’emploi de Radio-Canada, elle est aussi réalisatrice et travaille par la suite au service international. À partir de 1959, elle se démarque par ses reportages à l’étranger et devient la première femme à s’imposer comme grand reporter. En 1966, elle devient correspondante aux Nations-Unies à New York et première correspondante à l’étranger du réseau d’État. Considérée comme une pionnière du journalisme politique et de la presse électronique, elle se porte aussi à la défense de la langue française et de la culture. En 1972, elle reçoit la plus haute distinction du journalisme québécois, le prix Olivar-Asselin et depuis 1975, un prix de journalisme portant son nom est décerné annuellement.
La salle Marie-Gérin-Lajoie et le studio-théâtre Alfred-Laliberté ont aussi été nommés suite à la consultation de 1979. Marie Gérin-Lajoie (1867-1945), née Marie Lacoste, fait figure de pionnière dans l’établissement du mouvement féministe au Québec. Autodidacte, experte en droit, enseignante, conférencière et auteure de deux traités, ses luttes favorisent la redéfinition du statut de la femme et l’élargissement de ses droits. Elle milite pour la réforme du Code civil, l’accession des femmes aux études universitaires, aux carrières professionnelles et libérales et l’obtention du droit de vote pour les femmes. En 1907, elle fonde un organisme de promotion des droits civiques et politiques des femmes, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Sa fille, la révérende sœur Marie-J. Gérin-Lajoie, devient, en 1911, la première femme bachelière d’une université francophone au Québec en 1911 et fonde l'Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Alfred Laliberté (1878-1953), sculpteur, peintre, professeur et auteur, étudie le modelage dès 1896 au Conseil des arts et manufactures de Montréal et le dessin à la Société des arts de Montréal. De 1902 à 1907, il poursuit ses études à Paris, notamment à l’École des beaux-arts. En 1899, il récolte le prix d’honneur du Conseil des arts et manufactures et devient enseignant à cette école en 1907. De 1908 à 1943, il expose régulièrement aux salons de l’Art Association of Montreal et à l’Académie royale canadienne. En 1912 et en 1922 ont lieu à Montréal, deux expositions personnelles de ses œuvres. En 1922, il est nommé professeur à l’École des beaux-arts de Montréal. Surtout connu pour ses sculptures, il exécute principalement des bustes et des œuvres monumentales dont le monument à Dollard des Ormeaux (1920, Parc Lafontaine) et Le Monument des Patriotes de 1837 (1926, au Pied-du-courant).
Ce texte a été produit par le Service des archives et de la gestion de l'information.